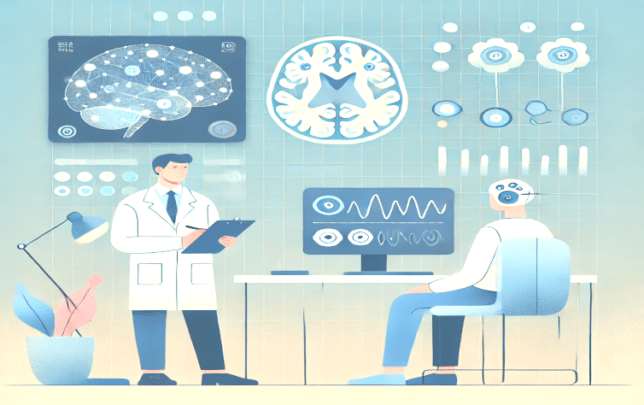L’art et l’esthétique, au sens où nous entendons ces termes aujourd’hui, sont des inventions récentes. La signification moderne du terme art date de la fin du XVIIIème avec l’identification des arts et des beaux-arts.
Auparavant, le terme d’art désignait, et ce depuis Platon, tout procédé de fabrication obéissant à des règles et aboutissant à la production d’objets. Mais si l’objet technique vise l’utile et satisfait clairement un besoin et n’est donc à ce titre l’oeuvre d’art en revanche n’a pas de fonction mais témoigne et signifie dans ce qu’elle donne à voir. Ou bien encore, alors que l’instrument ou la machine ne sont pas considéré pour eux -mêmes, n’étant que de simples moyens au service d’une fin qui leur est extérieure, l’oeuvre est au contraire considérée pour elle-même, selon ses qualités propres. Mais que ce soit l’oeuvre d’art ou l’objet utile, l’un comme l’autre témoigne d’un savoir-faire et obéissent à des règles de production, de composition.
Mais ce qui sépare profondément les conceptions antique et moderne est le statut même du beau. Tandis que pour la philosophie antique il existe des critères de la beauté que l’on pourrait qualifier d’objectifs, l’époque moderne a subjectivisé cette notion en la couplant avec celle de goût. L’usage novateur que fait Baumegarten aux XVIIIème siècle du terme esthétique dans un ouvrage consacré à la formation du goût consacre la séparation définitive entre l’objet technique et l’objet d’art. La où le terme de technè en grec désignait toute espèce d’objet fabriqué, il est désormais réservé à l’objet purement utilitaire. L’oeuvre d’art elle devient source d’un plaisir singulier, capable de nous affecter sur un mode propre.
I La conception antique
Alors qu’aujourd’hui nous abordons les oeuvres pour elles-mêmes, les livrant à une interprétations afin de découvrir les significations qu’elles recèlent et insistons sur les intentions conscientes ou non de l’artiste, l’antiquité s’attache d’abord non au sens de l’oeuvre mais à ce qu’elle donne à voir. Jusqu’à l’époque moderne, c’est en terme de modèle et d’imitation que l’on comprend l’oeuvre. Le premier auteur à théoriser le statut de l’oeuvre d’art fut Platon qui lie la question de l’art à celle de la vérité. Car l’oeuvre d’art recèle un pouvoir, elle peut influencer et tromper en donnant à prendre une apparence pour la réalité. C’est déjà ici une critique de l’image et une inquiétude quant à sa puissance d’influencer le jugement de celui qui en subit l’attrait. Cette question de la vérité de l’oeuvre et donc de la place de l’artiste dans la société, Platon la pose relativement à deux arts que sont d’une part la tragédie et d’autre part la peinture. Quel statut donner à ces oeuvres ? A quel type d’imitation avons-nous à faire ? Que montrent-elles ?
I Le statut de l’imitation dans l’antiquité.
Dans l’antiquité l’art, qui ne
La question de la poésie, et plus spécialement sous sa forme tragique, revient deux fois au cours de la République . A la fin du livre II (p.130) Platon reproche à Hésiode et à Homère d’avoir écrit des choses fausses à propos des dieux et constate que ces histoires ont toujours cours et se transmettent toujours de génération en génération. La Théogonie d’Hésiode raconte ainsi comment Zeus arriva au pouvoir, après que son grand-père et son père fussent châtrés. Platon recommande que de telles affirmations ne soient pas rapportées aux enfants qui auraient dès lors une bien mauvaise opinion des dieux, mais qu’au contraire les poètes s’attachent à suivre des modèles pour régler leurs propres discours, modèles définis par le philosophe :
Рle dieu est r̩ellement bon (et non pas batailleur ou querelleur)
– il est la cause des choses qui sont bonnes et non des autres (alors que les poètes ont tendance à en faire la cause des maux comme des biens).
– il ne change pas de forme pour se manifester sur terre, mais se maintient toujours dans la forme qui est la sienne ( des dieux, prenant l’apparence d’étrangers venus d’autres lieux, prenant toutes les formes, font le tour des cités : Odyssée, XVII). Car les dieux sont véridiques : ils ne peuvent chercher à nous tromper en produisant des simulacres. Sinon l’illusion devient chose divine. Mais qu’en est-il alors de la vérité ?
Et Platon de conclure : “Le dieu est parfaitement simple et vrai à la fois en actes et en paroles, et lui-même ne se modifie pas, ni ne cherche à égarer les autres, ni par des apparences, ni par des paroles, ni par l’envoi de signes, ni dans la veille, ni dans les rêves†382 e
La question de la véracité concerne également la sphère humaine. Les histoires qui sont racontées dans la cité doivent inculquer les valeurs fondamentales et développer chez les jeunes auditeurs les vertus nécessaires au maintien harmonieux de la société. Ainsi, Platon rejette de sa cité toutes les histoires concernant l’enfer et provoquant la crainte de la mort. Selon lui, il est impossible d’être véritablement courageux si cette crainte nous habite. Plus largement, c’est le rôle formateur du poète due Platon envisage ici : que doit-être le discours du poète pour mettre ces auditeurs dans des dispositions belles et bonnes et les inciter à la vertu ? Si la poésie entre dans le champ de l’éthique, c’est que celle-là possède un terrible pouvoir : celui d’imiter et ce pouvoir s’étant à toutes les réalités humaines comme divines. La question est alors de savoir ce qu’il faut imiter dans la poésie — et que le poète semble reprendre à son compte — et ce qu’il faut simplement rapporter. Car les jeunes âmes pâtissent de l’imitation sans pouvoir la critiquer : “Le jeune homme n’est pas encore capable de discriminer entre ce qui est intention cachée et ce qui ne l’est pas : en revanche les impressions qu’à son âge il reçoit dans ses opinions tendent à devenir difficiles à effacer et immuables. C’est sans doute précisément pourquoi il faut accorder une grande importance à ce que les premières choses qu’ils entendent soient des histoires racontées de la façon la plus convenable possible pour amener à l’excellence†(378 e). Le poète, parce qu’il produit des oeuvres qui s’adressent entre autres aux jeunes générations, doit prendre garde à donner de la vertu une bonne image et du vice une image qui provoque la répulsion. Le poète est responsable.
Les livre II et III posent donc la question de l’art en terme d’éducation, de vérité et d’illusion et de conformité à un modèle fixé par le philosophe. Dans le livre X, Platon exclut définitivement la tragédie de sa cité idéale. L’argument développé est un argument épistémologique : l’artiste n’a pas l’intelligence de ce qu’il représente, mais se contente de représenter les apparences des choses. Nous verrons que cette critique se déploie pleinement à partir du moment où l’artiste sera accusé de représenté les choses d’après l’effet que la représentation peut avoir sur le spectateur.
Pour nous aider à comprendre cette ignorance du tragédien, Platon prend l’exemple de la peinture imitative : “le peintre qui peindra un cordonnier ou un menuisier ou encore d’autres artisans alors qu’il ne connaît rien à leur art. Ainsi le peintre peut tout reproduire sans avoir l’intelligence de quoi que ce soit : il n’a pas besoin de connaître l’art du menuisier ou l’art du cordonnier pour peindre ces derniers (idem l’acteur).â€
Platon ne cesse d’insister sur l’éloignement de la vérité de toute reproduction (différence entre une photographie purement reproductive et une photographie d’art ?). C’est ainsi que le lit peint occupe le troisième rang : le premier rang est occupé par l’ eidos du lit, vers lequel regarde l’artisan pour fabriquer le lit, le lit sensible, qui occupe le second rang. Le lit peint lui occupe lui le troisième rang et est séparé de deux degrés du lit véritable, puisqu’il n’est que la production imagée de la semblance du lit.
Maintenant qu’en est-il de la tragédie ? Le premier grief de Platon à l’égard de la tragédie est semblable à celui contre la peinture imitative. Celle-la, en effet, est toujours susceptible d’abuser les spectateurs qui s’imaginent que la beauté de la tragédie ne peut avoir pour fondement qu’une connaissance ferme des réalités représentées. Ce qui veut dire que ce qui fait la valeur d’une tragédie, et plus largement d’une oeuvre d’art, ce à partir de quoi elle est jugée, est le plaisir qu’elle engendre, mais non à l’aune de la vérité des choses représentées. Or comme le peintre, l’auteur est éloignée de trois degrés de la vérité. Il manipule les images de certaines réalités avec pour seul souci de préserver une certaine vraisemblance et non de donner à voir ou à entendre la vérité.
Platon nous avertit : ne prenez pas les imitations de la tragédie pour la vérité de la chose imitée, car ces imitations agissent sur le sentiment, la sphère passionnelle avant de s’adresser à la raison. L’art ne peut rien nous enseigner parce qu’il ne repose pas sur une connaissance véritable des choses dont il prétend montrer des images, mais sur la connaissance de l’effet que ces images sont susceptibles d’avoir sur le spectateur. C’est dire que l’art flatte en nous l’élément déraisonnable lorsque par exemple la tragédie nous fait éprouver du plaisir au spectacle du malheur. L’art tragique nous fait aimer l’immoralité des passions, les crimes, au lieu de nous en donner le dégoût. L’art véritable doit conduire à la vertu et non au plaisir pris à la représentation des vices humains. Dans ce qui apparaît comme une condamnation de l’art, Platon met en regard des productions esthétiques un discours qui se présente comme un effort vers la vérité de ce qui est, qui cherche à saisir de toutes choses l’essence et non à plaire. C’est de cet effort dont il est question dans Le Banquet , où Platon, sous la forme d’un mythe, montre que le désir est dans son essence ascension vers la forme pure de la beauté. Au cours de cette ascension, l’âme s’élève du sensible vers l’intelligible, retrouvant une manière d’être, une consistance, une permanence qu’elle avait oubliées, perdues, dans son commerce avec les réalités sensibles.
2 Le beau et le bon
Dans Le Banquet , Socrate évoque son initiation, dans sa jeunesse, aux mystères de l’amour par une femme prêtresse nommée Diotime. Dans ce récit que lui fait Diotime, le désir, Eros, est personnifié sous la forme d’un démon, intermédiaire entre le divin et le mortel, conçu le jour le la naissance d’Aphrodite par Pénia (pauvreté) qui abusa de Poros, endormi ivre de nectar dans le jardin de Zeus. Il gardera des circonstances de se conception d’être éternellement amoureux de la beauté, de ce qui est délicat et parfait, toujours en chasse car de par son origine maternelle il manque du beau et du bien, mais il lui vient de son père de savoir si prendre pour combler ce manque et entre en possession de ce qui lui fait défaut. « L’objet de l’amour, affirme Diotime, est d’avoir à soi ce qui est bon, toujours ». Tension ente le mortel et l’immortel, le désir a pour cause la recherche de l’immortalité : le désir sexuel comme le désir de gloire ont en commun cet vers l’immortalité, vers la perpétuation de l’existence. Pour ceux qui sont féconds selon le corps, ils engendrent des enfants « s’assurant, s’imaginent-ils, l’immortalité, le souvenir et le bonheur »; quant à ceux qui sont féconds selon l’âme, c’est par la création qu’ils atteignent l’immortalité. Il est remarquable que dans cette analyse, Platon interprète le désir en termes de création, de puissance d’engendrement. Il y a certes au principe un défaut, un manque, celui de l’immortalité, mais le désir apparaît ici comme une protestation devant notre condition d’êtres mortels, comme un effort pour échapper à la finitude. Socrate le dit ailleurs ; ce que veut le vivant, c’est ne pas mourir. Entre la procréation et la création, Diotime pose une similitude : toutes deux sont une manière de ne pas mourir, soit par un prolongement illusoire de soi-même dans ses propres enfants, soit par la production de d’oeuvres qui pérennisent le désir, comme Homère ou Hésiode « qui laisser d’eux-mêmes des rejetons qui sont à même de leur assurer une gloire, parce que leurs poèmes sont immortels ».
Mais c’est dans la suite de son discours que Diotime révèle à Socrate la vérité du désir. En effet la nature de l’ascension de l’âme qui désir, le terme de cette ascension marquent les retrouvailles de l’âme avec une manière de connaître qui n’est plus celle de la connaissance sensible ou de l’opinion, toujours fluctuante et contradictoire. Passant de la beauté des corps (la beauté sensible) à la beauté
des âmes, puis à la beauté de certaines actions, de certaines lois, et enfin à la beauté que recèlent les sciences, l’âme, au terme de se parcours, finit par apercevoir la beauté en elle-même, beauté purement intelligible, réalité qui contrairement aux réalités sensibles, n’est pas soumise au changement, qui demeure à tout jamais identique à elle-même, absolument belle, mais dont toutes les choses que l’ont peut dire belles participent, dont elles sont davantage des reflets que des images. Dans le Phèdre , Platon insiste sur cette puissance de la beauté de provoquer la réminiscence de ces réalités intelligibles autrefois contemplées avant que l’âme ne s’incarne et ne se charge d’oubli en se tournant vers l’injustice et en laissant prédominer en elle la partie irrationnelle dans son rapport avec le sensible. Il lui devient désormais difficile de faire preuve de justice et de sagesse et de déchiffrer dans les choses d’ici-bas ce qui peut subsister de sagesse et de justice. Au milieux de ces reflets troubles, où l’on appelle justice ce qui en est la parodie ou encore liberté la servitude volontaire, il arrive d’être frappé par l’éclat de la beauté et de nous souvenir « du temps où nous en avions une vision bienheureuse, en ce temps où nous étions initiés à cette initiation qui mène à la béatitude suprême. Cette initiation, nous la célébrions dans l’intégrité de notre nature. Intègres, immuables et bienheureuses étaient les apparitions nous étions comblés, car dans la lumière pure, nous étions purs ». La beauté a cette propriété d’apparaître dans les réalités d’ici-bas que nous qualifions de belles avec le même éclat qui est le sien dans le lieu intelligible. Contrairement aux autres réalités intelligibles qui nous apparaissent voilées, la beauté se donne pour ce qu’elle est. Pour celui dont l’âme n’a que peu contemplé avant de s’incarner, la beauté n’évoque rien, et c’est à peine s’il la perçoit, préférant s’adonner aux plaisirs le plus vulgaires; mais pour celui qui a gardé en son âme la trace des réalités autrefois contemplées dans la plus heureuse félicité, c’est l’occasion d’être véritablement saisi par l’amour, dépossédé de lui-même dans une folie enthousiaste. Si la laideur est en désaccord avec le divin, la beauté, à l’inverse s’harmonise avec lui. Elle se fait intermédiaire entre l’âme et le divin, et parce qu’elle se présente ici telle quelle est en réalité par là -même elle permet à l’âme de se ressouvenir de l’intelligible, de retrouver sa patrie d’origine pour devenir féconde, produisant de beaux discours sur la sagesse et vertus, comme ces poètes qui composent de beaux vers ou ces législateurs qui promulguent de belles lois. Il apparaît donc que la notion de beauté ne soit pas limitée au seul champ esthétique ou artistique, mais se déploie également dans les champs éthiques et épistémologiques. La beauté, qui certes a un effet sur l’âme à travers le corps, provoquant cette espèce de délire, d’ivresse qu’est l’amour, a également à voir avec la vérité mais aussi avec le bien. Et cela n’a rien d’étonnant puisque le Bien se donne sous la triple forme de la beauté, de la vérité et de la juste mesure.
L’art ne peut donc être pour Platon une imitation servile du sensible, mais la manifestation de plus haut degré d’être. Si le divin est l’être au sens parfait et si la beauté est ce qui s’harmonise avec lui, alors tout ce qui manifeste de la laideur participe du non-être, souffre d’un défaut d’être. Est beau ce qui est pleinement et parfaitement ce qu’il doit être. Est laid tout ce qui incomplet. La conception de Platon revoie en dernière analyse à l’éclat resplendissant de l’Être premier d’où émane tout le visible et toute le connaissable. La beauté n’est autre que la lumière de l’être.
Si la beauté est ce vers quoi tend le désir, c’est qu’elle est d’abord ce qui s’harmonise le mieux avec le divin et donc l’éternel.
A côté de la condamnation de la tragédie, Platon dénonce la tendance qui est celle de la sculpture à son époque. En effet, les arts plastiques s’orientent toujours davantage vers le perspectivisme, c’est-à -dire qu’ils visent à une restitution des apparences fondées sur une illusion. Cela revient à faire du regard du spectateur la mesure de la beauté et de la vérité. L’art grec au Vème siècle recherche la vraisemblance et se soumet aux déformations de la visions, il corrige les formes et les proportions suivant le point de vue du spectateur.
Ainsi Platon distingue-t-il dans le Sophiste deux formes d’art imitatif :
– l’art de la copie : production d’images ressemblantes. Reproduction des proportions et des couleurs. L’artiste reproduit alors l’organisation proportionnée du modèle. Icône. Beauté = juste proportion.
– l’art du simulacre qui ne reproduit pas les proportions véritables mais celles qui paraissent belles. Le simulacre se fait passer pour le modèle. Il donne l’illusion de la vérité du modèle, il le produit. De plus, il vit de sa relation à l’icône, donc au modèle et de sa relation à l’effet visé dans l’âme du spectateur .Il s’appuie sur l’opinion que le spectateur a de la chose. Il inclut donc du non-être à son oeuvre.
L’art du simulacre repose sur l’illusion ou sur l’imagination. Alors que l’art grec est soumis à la doxa, qui se contente de l’apparence, l’art de la copie respecte l’essence de son modèle : il le reproduit tel qu’il est en lui-même sans se soucier de l’aspect sous lequel il apparaîtra. Cet art a pour seul souci l’ eidos . Il cherche la vérité du modèle et non le plaisant. Par exemple, l’art égyptien est dédaigneux du spectateur et il a gardé pendant des millénaires les mêmes canons : “Ils ont exposé les modèles (des belles figures) dans les temples, et ont défendu aux peintres de ne rien innover en dehors de ces modèles. En visitant leurs temples, tu y trouveras des peintures et des sculptures qui datent de 10 000 ans et qui ne sont ni plus belles ni plus laides que celles que les artistes font aujourd’hui, mais procèdent d’un art identique†( les Lois 656 d ). Dans l’art égyptien, ce n’est pas le spectateur qui est mesure de la chose représentée, mais la chose elle-même. La fonction de la statue égyptienne n’est pas de représenter une individualité mais de présenter son essence intemporelle. Par rapport à cette représentation de la divinité, le plaisir du spectateur est absolument négligeable. Ce sont les attributs essentiels et immortels d’un grand personnage qu’il s’agit de rendre présent. Davantage que l’art grec, l’art égyptien est un art profondément religieux, qui confirme le point de vue de Hegel : “C’est la vérité divine que l’art offre à la contemplation intuitive et au sentiment, et c’est cette vérité qui constitue le centre du monde de l’art tout entier†(Hegel, Esthétique , I).
Si la belle oeuvre est celle qui manifeste la vérité de la chose, qui la fait entrer dans le champ sensible, l’incarne pour ainsi dire, on ne peut manquer de poser la question de la relation entre vérité et beauté.
L’art a alors pour finalité d’exposer la vérité, de donner à voir les plus hautes réalités, nous arrachant à l’oubli, à la fascination qu’exerce sur nous d’ordinaire le sensible puisque dans l’oeuvre d’art, pourvu qu’elle soit belle et non pas simplement plaisante, c’est l’intelligible, le divin qui se donne à voir. La Beauté est le mode d’apparaître qui toujours révèle la présence de l’unicité essentielle : elle a pour effet de réunifier l’âme, le désir, de l’élever au delà de la fragmentation du sensible et donc de la fragmentation du désir qui passe d’un objet à un autre dans un oubli de lui-même. Eveil à la conscience de soi, l’oeuvre belle nous fait souvenir de notre nature véritable, car comment l’âme pourrait-elle connaître ces réalités impérissables si elle n’avait en partage avec elles une identité de nature ? L’oeuvre d’art nous rappelle à notre dignité, à notre rang et nous invite à fuir le non-être, c’est-à -dire le mal. « L’âme une fois purifiée devient une raison; elle devient toute incorporelle, intellectuelle; elle appartient toute entière au divin, où est la source de la beauté » (Plotin, Ennéades, I, 6 ). Délaissant la beauté où se mêlent encore le sensible, l’âme contemple heureuse, « dans sa simplicité et sa pureté, l’être dont tout dépend, vers qui tout regarde, par qui est l’être, la vie et la pensée; car il est cause de la vie, de l’intelligence et de l’être » et dont la beauté est celle de l’absolument réel.
Cet itinéraire auquel nous invite la beauté ne peut être compris en dehors de la psychologie platonicienne qui inclut le mythe de la transmigration des âmes et la contemplation par celles-ci des réalités intelligibles avant de s’incarner. Seulement il devient difficile pour un être humain de se remémorer ces réalités supérieures en partant de celles d’ici-bas, que l’âme de cet être humain n’est pu contempler les réalités intelligibles que brièvement ou que sa vie ici l’ai conduit à des fréquentations qui l’ont tourné vers l’injustice et donc à l’oubli de ces visions d’avant. Mais parfois il nous arrive d’éprouver cet étrange sentiment qui nous transporte hors de nous-mêmes, sans en comprendre la nature. Il faut dire, auparavant, que ni la justice, ni la sagesse, choses qui ont du prix pour une âme, n’ont rien de lumineux dans leurs images ici-bas, et qu’il est difficile de contempler la réalité imitée. Mais la beauté elle était resplendissante quand elle se trouvait au milieu de ces autres réalités intelligibles; et maintenant que nous sommes venus en ce monde, nous pouvons la saisir, brillante de la plus vive clarté, au moyen du sens qui a le plus de clarté. La beauté a cette prérogative de pouvoir être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat et ce qui attire le plus l’amour.
.
En effet, ce sont les conceptions antiques en matière d’art qui prévaudront en Occident jusqu’à l’époque moderne. La beauté se reconnaît à des qualités objectives, inscrites dans l’oeuvre et qui témoignent de son appartenance à la sphère de la vérité, du sacré, du numineux.
1 Intégrité et totalité :
Le bel objet doit tout d’abord être entier, présenter tous les caractères de la totalité comme unité d’une multiplicité. Cette entièreté signifie que rien de ce qui appartient à sa nature ne lui fait défaut. Est beau ce qui correspond complètement à ce qui doit être, ce à quoi il ne manque rien. Il s’ensuit que ne pourra être tenu pour beau que ce qui est parfait au sens de fini, achevé et terminé, ce qui se présente comme totalement réalisé. Seront considérés comme laids l’incomplet et l’inachevé. Se trouvent condamnés le fragment, l’esquisse, l’ébauche, l’oeuvre ou la chose qui ne sont pas parvenues à leur terme. Enfin, l’intégrité désigne le plein, ce qui est complètement rempli par l’être, et s’oppose ainsi au vide, à la faille ou au creux.
2 L’ordre et l’harmonie
L’idée de totalité n’est pas réductible à la seule notion d’intégrité. L’unité d’une multiplicité suppose aussi un principe d’ordre. La beauté, disait Plotin, réside dans “l’accord et la proportion des parties entre elles et avec le toutâ€. Pour que le composé soit une belle chose, il faut que ces parties du composé ou ces unités simples observent entre elles un ordre de détermination réciproque. La beauté de l’ensemble présuppose l’accord des parties entre elles et avec le tout grâce à l’ordre et à la proportion. Inversement sera laid ce en quoi on ne discerne aucune possibilité d’agencement des parties sous une forme commune, ce qui ne présente ni ordre ni proportion. Seront laids le déplacé, tout ce qui n’occupe pas son rang dans un ensemble, donc aussi le désordre, le disproportionné, le disloqué.
3 La simplicité et l’unité
La simplicité de l’idée correspond à ce qui n’est pas du tout composé. A la manière du simple idéal, la simplicité classique s’oppose à la complexité ou à la complication inutiles. Est esthétiquement simple ce qui représente et rend évidente l’unité fondamentale de sa nature. La manifestation de l’unité dans la simplicité exclut encore la parure ou l’ornement. Voir la règle classique que Boileau donne dans son Art poétique : unité de temps, de lieu, d’action et de caractères. Inversement seront laides la complication qui fait disparaître l’apparence de l’unité ainsi que la représentation d’une pluralité indéfinie. On condamnera également le superflu, ce qui n’entretient aucune liaison nécessaire avec le sujet ou le thème, l’excès de décoration, d’ornementation ou de parure.
4 L’immobilité ou la sérénité
La pensée grecque classique identifie la perfection de l’être, comme Idée ou comme le divin, avec le repos absolu, l’absence de toute altération, de tout changement. Le principe esthétique de l’immobilité exclut l’accidentel et le mouvement qui aboutissent à la déformation ou à l’informe. Le beau ne doit pas représenter ce qui ne dure pas, ce qui disparaît ou se transforme continuellement. Plutôt que l’accident, il faut viser l’essence seule qui subsiste sans altération. Il convient aussi d’éviter la représentation du mouvement pour lui-même, s’il ne tend pas vers le repos, et la transformation excessive qui aboutit à la disparition de la forme.
5 La félicité
Parce que l’être parfait exclu tout manque, qu’il est pleinement et totalement ce qu’il doit être, son état qualifie aussi la perfection du bonheur. Le principe de félicité signale la proximité fondamentale de la beauté classique avec le bonheur et le souverain Bien. La beauté esthétique devient alors la représentation et la manifestation du bonheur parfait comme accord avec soi-même et volonté de demeurer dans son état. En même temps, l’émotion esthétique peut naître du spectacle de l’impossibilité pour l’homme d’atteindre ou de conserver cette félicité divine. Il y a dans l’appréhension classique de la tragédie cette aspiration, d’autant plus forte qu’elle est davantage contrariée, à la félicité parfaite de la divinité.
6 La clarté
Comme la beauté classique est l’éclat de la perfection de l’être, et comme l’analogie platonicienne de l’Idée suprême du Bien avec le soleil doit être prise au pied de la lettre, il s’ensuit que la beauté est très étroitement liée à la lumière. C’est pourquoi toute représentation de la lumière; toutes les couleurs lumineuses et claires, le contraste de la clarté et de l’obscurité, la luminosité de la matière elle-même, tout ce qui dépend de la lumière et qui l’amplifie pourra être considéré comme beau. Inversement, le sombre, l’obscur, de même que le voilé ou le caché, c’est-à -dire tout ce qui affaiblit la vue ou empêche de voir, reconduisent à la laideur. Mais la beauté classique ne s’oppose pas seulement à l’obscurité, elle exclut également le flou, l’imprécis, le confus et l’indistinct. La clarté classique, en tant qu’elle est esthétique, est aussi une clarté intellectuelle ou théorique. Est beau ce qui se voit bien, ce dont tous les contours, toutes les limites, tous les détails sont pleinement et complètement apparents. La clarté esthétique renvoie à l’idée claire et distincte, cartésienne.
7 La vérité
Enfin, comme la beauté, en tant que visibilité essentielle de l’être, est ce qui rend possible la vision théorique et sensible, c’est-à -dire la connaissance et la perception, la beauté sera nécessairement vraie, puisque la vérité n’existerait pas sans elle. Ou encore, comme la beauté est l’existence visible de l’essence, pourra être dit beau tout ce qui est exactement conforme à sa définition, tout ce qui sera en vérité ce qu’il doit être.â€Le vrai seul est aimable†(Boileau). Seront réputés laids, le faux, l’invraisemblable, l’impossible et le mensonge.
II L’esthétique kantienne.
A la suite des critiques empiristes faite à l’ontologie classique, la notion de beauté subit des remaniements profonds qui la ramènent du côté du sujet. En effet pour le courant empiriste anglo-saxon, dont John Locke au XVIIème siècle fut l’initiateur, nous n’avons jamais à faire qu’à nos propres sensations qui sont soumises spontanément par l’esprit à un travail d’élaboration qui conduit à la conceptualisation, c’est-à -dire à des notions générales qui naissent d’une multiplicité de sensations présentant des caractères communs. Le fondement du savoir n’est autre que l’expérience sensible et non ces idées qu’il s’agirait d’atteindre au terme d’un travail dialectique. Contrairement à la philosophie platonicienne qui postule l’existence d’idée intelligible indépendante du sensible, l’empirisme affirme que la connaissance n’est qu’une interprétation de nos sensations et que du même coup cette connaissance ne peut prétendre à la vérité en dépassant le plan du sensible. C’est toute la métaphysique occidentale qui se trouve du même coup ébranlée. Or cette métaphysique et ce depuis Descartes en particulier, constituait l’armature épistémologique de la science. Avec cette révolution épistémologique qui se joue en Angleterre, c’est l’idée même de science qui se trouve profondément bouleversée. Si les concepts ne sont que le résultats d ‘une élaboration par l’esprit de nos sensations, alors nous ne pouvons prétendre connaître les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes. En effet, plus rien ne vient garantir que le discours dit le réel : réduit au plan des apparences, il ne fait que dire la réalité.
A la suite du trouble provoqué par la philosophie empiriste, Kant va tenter de monter la possibilité de sauver la science, c’est-à -dire la possibilité d’une connaissance universelle et non pas seulement générale parce que soumise aux résultats finalement contingents de l’expérience sensible. Kant accorde aux empiristes le fait que nous n’ayons accès qu’aux phénomènes et que nul discours ne peut prétendre dépasser le plan strictement phénoménale pour s’aventurer dans le supra sensible et poser des jugements nécessaires sur des réalités échappant à sensation (Dieu, l’âme). La raison doit opérer sa propre critique, c’est-à -dire reconnaître ses limites, mais elle reste néanmoins législatrice à l’intérieur de ces limites. Dire cela, c’est affirmer que la science est possible, autrement dit qu’il est possible de poser la nécessité des relations causales entre les phénomènes, là où l’empirisme ne voyait que des consécutions, des répétitions que l’on prenait à tort pour des liens de cause à effet. En sauvant la causalité, Kant sauve la science, mais se voit obligé de sacrifier la métaphysique traditionnelle héritée de l’antiquité. En effet, la causalité n’est plus inscrite dans les choses, mais elle est une exigence de l’esprit. La nature reste pour Kant l’existence des choses, en tant que cette existence est déterminée selon des lois universelles. Peut-on d’ailleurs encore parler de chose si les choses en elles-mêmes sont inconnaissables ? Kant ne parle plus de chose mais d’objet. L’objet est constitué à partir d’un ensemble de sensations, qui procèdent d’impressions mises en formes selon les principes de la sensibilité que sont l’espace et le temps, sensations qui sont soumises à l’entendement, faculté structurante qui au coeur d’une pluralité sensible distingue quelque chose qui demeure et des qualités qui par ailleurs peuvent être changeantes ( principe de la permanence : Tout les phénomènes contiennent quelque chose de permanent (la substance) considéré comme l’objet lui-même, et quelque chose de changeant, considéré comme une simple détermination de cet objet, c’est-à -dire d’un mode d’existence d’objet) . Mais l’objet est déjà une interprétation, une construction, une représentation. Kant est d’accord en cela avec l’empirisme : nous n’avons à faire qu’à nos représentations. Affirmer que l’objet est identique à ce qui est à l’origine des impressions qui lui ont donné naissance dans l’esprit, c’est un pas qu’on ne saurait franchir sans affirmer plus qu’on ne peut savoir.
Parler d’universalité, c’est affirmer une connaissance touchant à la nature en amont de toute expérience particulière, a priori . Cette universalité est le fait de la raison : celle-ci exige de pouvoir classer, hiérarchiser les phénomènes, bref de parvenir à une connaissance systématique. L’entendement, loin de tirer ses lois de la nature, les lui prescrit au contraire (il s’agit là des lois pures ou universelles de la nature qui structurent toute expérience et non des lois empiriques de la natures qui supposent toujours des perceptions particulières). Ainsi le principe de causalité, qui pose une nécessité dans l’enchaînement des phénomènes repose en fin de compte sur le principe a priori
que Kant nomme principe de la production : Tout ce qui arrive (commence d’être) suppose quelque chose à quoi il succède, d’après une règle. Et c’est précisément parce que nous soumettons la succession des phénomènes à la loi de causalité qu’une expérience est possible, c’est-à -dire la connaissance empirique de ces phénomènes; par conséquent, ils ne sont eux-mêmes possibles, comme objets de l’expérience, que suivant cette loi. La valeur objective de nos représentations vient de leur soumissions aux principes de l’entendement, lorsque la connaissance des rapports de succession entre les phénomènes est valable pour tout le temps, c’est-à -dire objectivement valable.
Si nous ne connaissons les choses en elles-mêmes, cela est dû selon Kant à notre condition : pour qu’une connaissance puisse être élaborée, encore faut -il que quelque chose nous soit donné, autrement dit intuitonné. Or ceci est le fait de la sensibilité, sensibilité dont les formes premières sont le temps et l’espace. A parler en termes rigoureux, les choses ne sont ni dans le temps ni dans l’espace : être dans le temps et dans l’espace sont des prédicats joints aux choses en tant qu’elles nous apparaissent, c’est-à -dire qu’elles sont des objets de la sensibilité, des phénomènes. Toutes les choses en tant que phénomènes sont dans le temps est un principe objectif et universel de manière a priori, puisque le temps comme forme du sens interne est condition de toute représentation.
Connaître pour Kant, c’est toujours connaître par concept, concept qui résulte de l’unification par l’entendement de nos perceptions, qui sont elles-mêmes une synthèse produite par l’imagination de nos sensations. L’imagination dite ici reproductrice est cette faculté qui est intermédiaire entre entendement et sensibilité, qui coordonnent les divers sensations selon des schèmes, ou des schémas, qui sont des images temporelles des concepts de l’entendement : ainsi le schème de la substance est la permanence dans le temps, ce qui demeure identique; le schème de la nécessité est l’existence d’un objet en tout temps; le schème de la réalité est l’existence dans un temps déterminé; le schème de la causalité est ce qui une fois posé est toujours suivi de quelque autre chose. Une représentation n’est objective qu’à la condition d’obéir aux conditions qui en font un objet, autrement l’objet est une objectivation lorsque nos représentations sont soumises aux principes de l’entendement.
Ce détour par l’épistémologie kantienne nous montre que l’objet est d’abord le résultat d’une rencontre : rencontre entre des données sensibles qui sont ordonnées selon les deux formes de la sensibilité que sont le temps et l’espace puis structurées par les concepts et principes de l’entendement qui constituent l’armature logique de toute perception.
Si l’objet et ses propriétés ne résulte en fin de compte que d’une interprétation de données sensibles, que devient dans un tel contexte la beauté ? Alors que la philosophie platonicienne insiste sur la capacité de l’intelligence à saisir des Idées qui permettent de penser la vérité des choses, ce qu’elles sont en elle-mêmes, la philosophie kantienne semble nous priver d’une forme de connaissance absolue, n’étant plus désormais que relative à nos moyens de connaître. Une fois adoptée la critique empiriste qui dénonce la naïveté d’un discours qui prétendrait connaître les choses en elles-mêmes, comment parler de la beauté sans relativiser la notion à l’extrême et poser comme mesure de la valeur esthétique d’une oeuvre le goût individuel ? Quel sens y a-t-il à parler de beauté si il nous est impossible de connaître la beauté en soi ? Comment juger l’oeuvre d’art, sa valeur esthétique si désormais le suprasensible nous est interdit ?
La première caractéristique du jugement de goût est que le jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance. Alors que la beauté selon Platon supposait l’accord d’une réalité sensible avec son idée (ou son concept), il ne peut être question dans le cadre d’une philosophie critique de rapporter la représentation d’une chose à son idéal. En effet, pour qualifier une chose de belle, nous ne rapportons pas la représentation à l’objet par l’entendement en vue de connaître l’objet, mais nous la rapportons par l’imagination au sujet et au sentiment de plaisir ou de déplaisir du sujet. Autrement dit, le jugement de goût n’est pas un jugement déterminant, par lequel nous appliquons un concept à un objet pour élargir notre connaissance. Il ne s’agit pas d’un jugement objectif mais purement subjectif, c’est-à -dire réfléchissant qui traduit la manière dont la faculté de juger se trouve déterminée par une représentation. Le jugement esthétique ne dit rien de l’objet, mais traduit le plaisir que ressent le sujet dans la rencontre de tel ou tel objet. La beauté n’est donc pas une propriété de l’objet : le jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance.
Deuxième caractéristique : le jugement esthétique est un jugement désintéressé. On appelle en effet intérêt « la satisfaction qui est liée à la représentation de l’existence d’un objet ». Ce type de satisfaction est toujours en relation avec le désir, autrement dit avec le sens ou l’importance que peut avoir un objet pour tel ou tel individu, ou pour l’agrément que cet objet peut apporter. Or il ne s’agit ici que de savoir si la pure et simple représentation de l’objet s’accompagne d’une satisfaction, indépendamment de l’existence de cet objet ou de sa possession. Le jugement de goût n’est pur, autrement dit, impartial qu’à la condition que soit écarté tout parti pris, que soit adoptée une sorte de neutralité idéologique ou bien encore qu’il ne soit en aucune manière conditionné par la nature de l’objet. C’est un jugement contemplatif. La satisfaction esthétique est une satisfaction libre que Kant nomme « faveur » et qu’il distingue de la satisfaction relative à l’agréable et de celle relative au bien, qui supposent toutes deux que soit pris en compte l’existence de la chose qui devient principe déterminant du désir pour l’agréable et de la volonté pour le bien.
Est agréable, dit Kant, ce qui plaît au sens dans la sensation : autrement dit l’agréable est le plaisir des sens. L’intérêt pour l’existence de l’objet vient du fait précisément de ce plaisir sensuel qui réclame la répétition du contact avec l’objet capable de procurer pareil plaisir. Pour le dire autrement, dire qu’une chose est agréable, c’est désirer nécessairement l’existence de la chose dans sa matérialité. Il y a là un désir pour la chose déterminé par la sensation, un effort vers la possession.
Il en va de même pour le bien. Est bon dit Kant ce qui plaît à la raison, de par le seul concept. Nous disons bon à quelque chose (l’utile) ce qui plaît comme moyen; mais nous disons bon en soi ce qui plaît par soi-même. Qu’il s’agisse d’une forme ou de l’autre, parce que il s’agit de rapporter l’objet à une fin, il y a toujours un intérêt pris à l’existence de l’objet, soit parce qu’il est à réaliser étant donnée sa bonté, soit parce qu’il permet de réaliser une fin. Dans un cas comme dans l’autre le concept de l’objet détermine la volonté, qui produit l’objet selon l’intérêt de celui-ci, comme moyen ou du fait de sa valeur intrinsèque. Le bien est objet de la volonté, c’est-à -dire de la faculté de désirer déterminée par la raison. « Vouloir quelque chose et trouver une satisfaction à son existence, c’est-à -dire y prendre un intérêt, c’est la même chose » (§4) Or souligne Kant, nul concept n’est requis pour trouver de la beauté, puisque des fleurs, des dessins libres (iTunes) qui ne signifient rien peuvent être source d’un plaisir esthétique.
Au terme de ce travail de distinction, Kant nomme inclination la satisfaction purement sensible, respect le sentiment purement moral qu’inspire la loi morale qui oblige l’individu et marque en lui cette capacité à agir selon des mobiles qui ne relèvent pas de l’inclination mais de la raison, et donc enfin la faveur, faveur de l’oeuvre qui se donne, sans que ne précède aucun besoin, rencontre libre et sans contrainte. La première définition du beau se fait donc à partir de celle du goût : Le goût est la faculté de juger et d’apprécier un objet ou un mode de représentation par une satisfaction ou un déplaisir, indépendamment de tout intérêt. On appelle beau l’objet d’une telle satisfaction.
Libre de tout intérêt, le jugement esthétique est universalisable. La deuxième définition que donne Kant du beau est la suivante : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept », ou bien encore : »Le beau est ce qui est représenté comme l’objet d’une satisfaction universelle ». Contrairement à l’agréable qui particularise le jugement porté sur l’objet parce que s’adressant exclusivement aux sens, donc à une sensibilité particulière, le jugement esthétique est en droit valable pour tous. « En ce qui concerne l’agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu’il fonde sur un sentiment personnel et privé, et en vertu duquel il dit qu’un objet qu’il lui plaît, soit du même coup restreint à sa seule personne » (§7). Quand on dit trouver une chose belle, on juge comme si la beauté était une propriété de la chose et donc comme si tous devait de la même manière éprouver le même plaisir : il serait ridicule d’affirmer ce poème est beau pour moi.
Cette universalité se distingue de l’universalité du jugement de connaissance en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun concept de l’objet : la validité du jugement de goût est purement subjective contrairement à la validité d’un jugement de connaissance qui elle est objective.
En effet, dans le domaine de la connaissance, la validité d’un jugement, sa vérité et donc son universalité lui vient de la nécessité du lien entre le prédicat et le concept de l’objet : connaître un objet c’est affirmer de cet objet une certains nombres de propriétés, d’attributs qui appartiennent à son concept soit d’un point de vue strictement logique, soit relativement à l’expérience. Or la validité universelle subjective du jugement esthétique ne repose sur aucun concept qui puisse fonder la nécessité objective du lien entre l’objet et le fait d’être beau. Et ce pour la bonne raison que la représentation de la chose est immédiatement rapportée au sentiment de plaisir sans se fonder sur le concept de l’objet. Le jugement ne dit pas quelque chose de l’objet, mais de la satisfaction, du plaisir éprouvé par la sujet. Kant se sépare ici définitivement du paradigme classique qui rapportait l’objet à son concept pour en mesurer le degré de perfection et donc de beauté et qui du même coup en garantissait l’universalité. Le jugement esthétique ne renvoie qu’à un certain état d’esprit, une satisfaction libre (de tout concept) qui n’est rien d’autre que le libre jeu des facultés, qui stimule l’activité de connaissance : le beau donne à penser, donne à rêver, fait surgir en nous des impressions. Ce qui fait le paradoxe du jugement esthétique est qu’il conserve une prétention à l’universalité sans se fonder sur la connaissance du concept d’un objet. Dès lors, l’état d’esprit qui fonde le jugement esthétique est présupposé comme universel, précisément parce que contrairement à l’agréable, il ne repose pas sur la sensibilité.
La troisième thèse est une conséquence de l’absence de tout concept fondant le jugement esthétique : « La beauté est la forme de la finalité d’un objet en tant qu’elle est perçue en celui-ci sans représentation d’une fin ». La forme de finalité désigne l’intentionnalité qui est à l’origine de l’existence d’un objet, intentionnalité associée au concept de l’objet dont il est la réalisation. « La causalité d’un concept par rapport à son objet est la finalité ». Le concept d’un objet peut être la cause d’un objet à condition qu’il soit le but d’une action consciente, autrement intentionnelle. Dire qu’un objet est beau suppose pour Kant que celui-ci donne l’impression d’avoir été réalisé en fonction d’une intention, sans que l’on puisse définir, cerner précisément cette intention (ce qui permet d’ailleurs le libre jeu des facultés).. Car la définir supposerait que l’on détient un concept de l’objet, auquel on le comparerait. Ce serait retomber dans le paradigme classique qui suppose une connaissance de ce que doit être la chose à partir du moment où l’on est capable d’en connaître l’idée, or Kant pose nettement que « le jugement de goût est entièrement indépendant du concept de perfection ». A partir de cette finalité sans fin, Kant distingue néanmoins deux types de beauté :
– La beauté adhérente qui se rapproche de la conception classique, en ce qu’elle suppose un concept de ce que la chose doit être. Qualifier un objet de beau en ce sens résulte d’une évaluation de l’écart qui le sépare de son concept. Mais un tel jugement est en fin de compte un jugement de connaissance et non un jugement esthétique