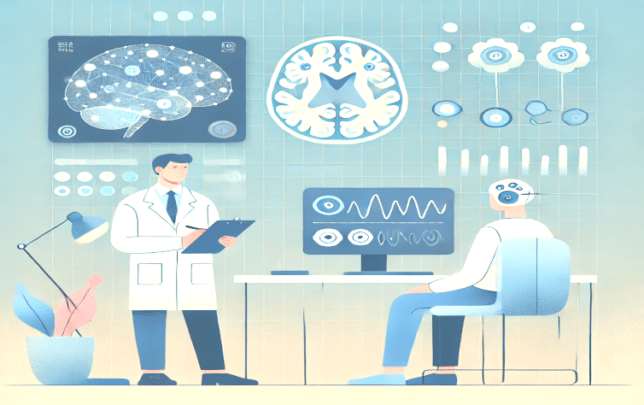Dans bien des cas, l’adulte mésestime la capacité de compréhension ainsi que la détresse émotionnelle de l’enfant face à des événements traumatiques. Son mutisme est bien souvent interprété à tort comme une indifférence ou encore un manque suffisant d’évaluation de la gravité de la situation. Ce qui induit l’adulte à cette mésinterprétation, c’est le détachement à partir duquel l’enfant opère au regard d’une expérience dramatique.
Cependant, ce silence peut dans certains cas traduire, une stratégie de protection psychique adoptée par l’enfant pour préserver son intégrité face à une souffrance trop accablante. Il se dissimule derrière une armure protectrice, initialement salutaire, puisqu’elle constitue une défense, ou un mécanisme adaptatif, visant à la sauvegarde de son intégrité psychique. Ce mécanisme protecteur prend de l’épaisseur avec le temps, et peut rapidement se transformer en un fardeau émotionnel de plus en plus lourd à porter.
Ce mutisme prolongé, s’étendant de quelques instants à quelques mois ou quelques années, s’ancre dans un champ émotionnel complexe, entremêlant des sentiments tels que la honte, la crainte et la culpabilité, notamment quand le traumatisme impacte le corps. Ces émotions, parfois trop confuses, écrasantes pour l’enfant, entretiennent ce silence prolongé, générant ainsi, une distance émotionnelle entre lui et son entourage que chacun interprètera selon sa propre perspective, sans s’apercevoir, qu’il dissimule le réel d’une profonde souffrance.
« Elsa, 21 ans, raconte le silence prescrit par son père : « Il ne faut pas que tu le dises à maman, cela doit rester entre nous. Tu es folle, personne ne te croira, on te prendra pour une affabulatrice. »
Kevin, 41 ans, témoigne de ses années de silence, violé par son instituteur : « j’avais peur d’en parler à des adultes, car je me sentais coupable».
Elie martyrisé par ses parents depuis son plus jeune âge explique à 16 ans « je n’osais rien leur dire, j’étais convaincu que c’était de ma faute, ils n’arrêtaient pas de me répéter que je n’étais qu’une mauvaise graine, un bon à rien et que je n’aurai jamais dû être leur fils ».
Louis, victime à 11 ans de son professeur de mathématiques, explique qu’il était « tétanisé par la peur d’assister aux cours. La seule réponse prononcée par mes parents était de me mettre au travail, sans jamais tenter de percevoir, ce pourquoi je n’y parvenais pas. On garde alors pour soi la honte, l’humiliation, on se sent seul «.
Évoquer la culpabilité, c’est convoquer cette instance morale qui édicte les normes du bien et du mal, initialement extérieure à l’individu, héritée des valeurs parentales et sociétales. Peu à peu, cet ensemble de valeurs intégrées forme en l’enfant une instance interne, le surmoi, une sorte de tribunal de la conscience. Au cours du déclin de la période œdipienne, l’enfant s’identifie à ses parents et intègre leurs exigences et interdits.
Selon Freud, le surmoi agit comme un censeur incarnant la loi, interdisant toute transgression.
Mélanie Klein avance la théorie d’un développement précoce du surmoi, dès les premières phases du développement psychique, notamment lors de la phase orale. Selon cette perspective, le surmoi, représentant les normes et les valeurs internes, peut commencer à se former dès les premiers stades de la vie. Klein souligne également l’intensité du sadisme infantile à ce moment précis du développement, suggérant ainsi une corrélation entre les premières étapes du développement psychologique et l’émergence de cette facette de la personnalité.
De nos jours, certains psychologues et chercheurs remettent en question la notion de « sadisme infantile » telle que décrite par certains psychanalystes comme Mélanie Klein. Ces remises en question émanent principalement des avancées dans la recherche en psychologie du développement, des neurosciences et de la psychologie clinique contemporaine, où l’approche psychanalytique n’est pas toujours centrale.
En d’autres termes, les comportements dits « sadiques » chez l’enfant peuvent être lus comme la résultante de problèmes développementaux, d’influences environnementales ou de difficultés émotionnelles plutôt que de tendances intrinsèques de cruauté.
Les valeurs et les croyances transmises par les tuteurs de développement ne sont pas simplement adoptées par l’enfant mais sont intégrées à leur propre système de valeurs. Cela se traduit parfois par des conflits internes, où des émotions comme la culpabilité sont ressenties en fonction de la perception personnelle des actions, indépendamment des actes eux-mêmes. Dit autrement, la culpabilité découle souvent de l’interprétation personnelle d’une action plutôt que de l’action elle-même.
L’enfant, dont l’imagination est dite féconde, mais aussi stimulée par l’environnement adulte, peut trouver diverses raisons de se sentir coupable. Ce qu’il exprime en termes de culpabilité, à la fois conscient et inconscient, peut diverger des projections et de la logique adulte. L’éducation connote un rapport d’autorité entre l’enfant et l’adulte, qui n’est pas exempte d’ambiguïté selon laquelle, le jeune, doit combiner envers l’adulte obéissance en même temps que méfiance lorsque ce dernier est étranger à son cercle proche.
L’autonomie de l’enfant face aux consignes de préservation du silence, déterminera la force du secret imposé par un agresseur. Un enfant sécurisé donc confiant vis-à-vis de l’exploration du monde extérieur conscient des limites à dépasser de celles à ne pas franchir, pourra davantage s’affranchir d’une injonction au silence, habillé par l’invitation au secret et résister aux pressions de l’agresseur.
A contrario, l’enfant insécurisé fera restera »loyal » envers son agresseur ou son prédateur et se murer dans un mutisme , le dépossédant de sa parole. Le silence peut également découler d’un processus d’emprise et d’identification à l’agresseur, en particulier dans les traumatismes intentionnels prolongés. L’auteur des violences entraîne l’enfant dans une dépendance émotionnelle et psychique, ébréchant sa confiance en lui, l’isolant et le maintenant dans la terreur qui l’empêche de dénoncer ses souffrances.
L’observation du silence par l’enfant, le préserve d’un monde adulte figuré comme hostile, par la crainte de ne pas être cru.
Lena décrit les pressions subies de sa mère suite à sa révélation : « si tu parles l’école portera plainte, ton père ira droit en prison et on finira par crever de faim. » « C’est ce que tu veux ? tu veux briser toute ta famille après tout ce qu’on a fait pour toi ?. »
Dora, 14 ans, agressée sexuellement à de nombreuses reprises par des camarades de classe, explique : « je n’ai rien dit, personne ne m’aurait cru, de toute façon ici il y a deux mondes, celui des forts et celui des faibles et ce sont toujours les mêmes qui ont raison. Je n’avais aucune chance d’être cru, je n’étais qu’une élève faible qui aurait mieux fait de n’être jamais venu au monde. Mes parents m’auraient demandé de m’adapter »
La solidarité entre adultes peut se révéler fortement ressentie par les enfants victimes d’inceste. Les données issues de diverses études (référence 3) indiquent que lorsqu’un cas d’inceste est dévoilé, 43 % des mères prennent position contre l’agresseur, mais seules 20 % d’entre elles soutiennent simultanément l’enfant dans sa démarche. En parallèle, 13 % réagissent négativement envers l’enfant et 10 % expriment de l’indifférence à l’égard de la situation.
Lorsqu’un enfant est confronté à un abus sexuel, il est fréquent qu’il se trouve enserré dans une réalité où la loyauté s’avère être un enjeu impossible. Dans cette dynamique, il se trouve parfois contraint de s’adapter à cette difficulté dans laquelle il sombre souvent dans l’impasse, le forçant à développer des mécanismes de survie, parfois en adoptant la perspective de l’agresseur pour rationaliser les actes abusifs, tout en ressentant un danger imminent.
Pour décrire les réactions spécifiques des enfants confrontés à ces abus, le concept de « syndrome d’accommodation » ainsi que celui des « îlots de survie » sont évoqués. Ces termes renvoient à la tentative de l’enfant de se reconstruire et de récupérer son intégrité, par le biais de la dissociation de sa réalité psychique pour survivre, ou par une identification à l’agresseur pour se protéger. Ces mécanismes peuvent générer de profonds conflits intérieurs et une culpabilité intense.
Le choix du silence de la part de l’enfant peut s’interpréter comme une tentative de préserver ses proches d’une douleur supplémentaire. Il se garde ainsi sa souffrance pour lui-même, cherchant à éviter de heurter ou d’inquiéter son entourage par ses révélations
Ninon, 7 ans, qui a perdu sa main et son petit frère de trois mois dans un accident, nous explique se « forcer à ne jamais pleurer » devant son père. « Sinon il va croire que j’ai trop de chagrin et cela va lui faire encore plus de peine. » « Alors quand ça me fait trop mal je pleure dans les toilettes ou la nuit sous ma couette. Papa des fois je vois bien qu’il a pleuré, il a les yeux tout rouges. Et quand je lui demande, il me dit que non… Pourquoi il ne me fait pas confiance ? C’est parce qu’il croit que je ne peux pas comprendre… je ne sers à rien… c’est comme un secret qu’il ne faut pas dire alors qu’on y pense tous. »
Sarah, âgée de 6 ans, a perdu son frère dans un attentat. Depuis près d’une année, elle n’a jamais évoqué son frère, précisant qu’elle n’en parle « à personne ». Elle explique : « Au début, quand quelqu’un mentionnait son prénom, maman pleurait beaucoup… Je ne veux pas pleurer devant maman et papa, mais le soir, quand je suis seule dans ma chambre… ou à l’école, dans un coin où personne ne me voit,… Pourquoi je ne pleure pas ? Parce que si je pleure, cela fera couler à nouveau les larmes de maman. » Sarah s’impose une autocensure en public, évitant de prononcer le prénom de son frère durant les premiers mois de prise en charge. Elle utilise une expression distante en disant « il », sans même parvenir à utiliser l’expression « mon frère » pour évoquer le lien fraternel. À travers un travail thérapeutique familial, Sarah et ses parents ont progressivement commencé à aborder le sujet de Ben sans craindre d’être émotionnellement submergés.
Le silence des enfants peut aussi représenter une stratégie de défense contre les traumatismes, empêchant la résurgence des souvenirs effrayants. Solène, blessée lors d’un l’attentat, explique : « Je préfère ne plus en parler, car à chaque fois ça ravive les images de l’attentat. Ce mécanisme permet à l’enfant ou à l’adolescent de tenir à distance les souvenirs traumatiques pour éviter de raviver la douleur psychique et d’être submergé à nouveau par ces manifestations. Cependant, ces mécanismes de défense ou d’adaptation restent fragiles, car dès que la vigilance diminue, les souvenirs douloureux resurgissent.
Le silence peut également refléter la perte de confiance envers les adultes sollicités en vain par l’enfant. Il peut avoir expérimenté le rejet ou l’incrédulité d’adultes incapables de comprendre l’horreur subie, ou avoir été envahi psychiquement par des adultes fascinés par son histoire.
Un exemple saisissant est celui de Betty, 7 ans, prostrée et mutique après avoir perdu son pied dans un éboulement. Elle exprime un profond chagrin face au mensonge des adultes en qui elle avait une confiance absolue. L’absence de réponses honnêtes et la terreur de ne pas comprendre pourquoi son pied a été amputé l’ont plongée dans un silence protecteur pour éviter les fuites et les mensonges déstabilisants.
Cet exemple souligne la difficulté pour un enfant de partager sa douleur, d’autant plus lorsque les adultes face à lui sont eux-mêmes blessés ou espèrent qu’il n’a rien compris ou ressenti.
Dans ces cas, les enfants se retrouvent contraints de garder le silence devant leurs proches, gardant ainsi leurs souffrances cachées et non partagées.
Soutenir un enfant dans cette détresse demeure toujours un défi pour les adultes. Cependant, si les proches peuvent exprimer leur propre chagrin devant l’enfant, cela peut lui permettre de pleurer librement, de partager sa peine et de maintenir le lien de confiance essentiel pour continuer à vivre malgré le chagrin et la douleur.
Lorsqu’un enfant se retrouve seul face à sa souffrance, il peut développer ce que Boris Cyrulnik nomme « le clivage résilient », une stratégie à partir de laquelle une partie de lui identifie la réalité, tandis que l’autre la dément. Ce mécanisme adaptatif favorise sa survie par la mise à distance ses souvenirs traumatiques. Cependant le coût psychique peut-être fort onéreux pour lui, imposé par le silence qu’il s’est imposé.
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6279881/